Le destin exceptionnel du monde dans Le Labyrinthe des égarés d’Amin Maalouf
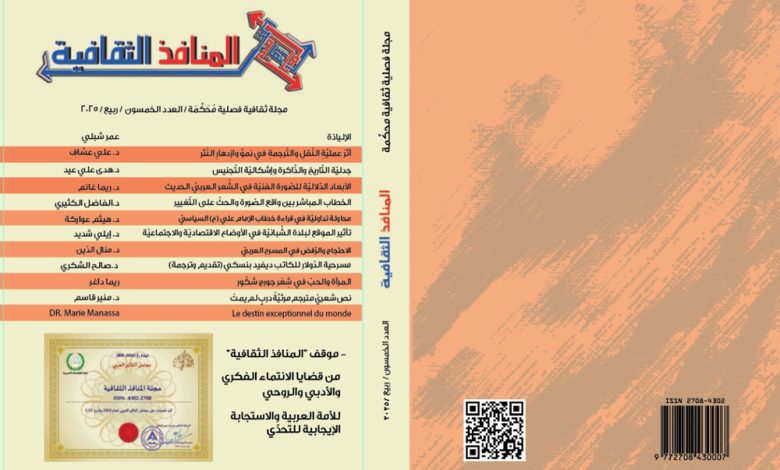
Le destin exceptionnel du monde dans Le Labyrinthe des égarés d’Amin Maalouf
القدر الاستثنائيّ للعالم – رواية متاهة الضائعين لأمين معروف نموذجًا
DR Marie L. Manassa
د. ماري هنري منسى
تاريخ الاستلام 8/12/ 2024 تاريخ القبول 20/12/2024
Résumé
Expliquer l’évolution de l’arène internationale, saisir avec mesure et justesse la réalité mouvante et complexe de l’Orient et de l’Occident est une entreprise téméraire. A la difficulté de recenser dans une grille cohérente les données politiques, économiques, culturelles en œuvre dans la marche des évènements, se mêle intimement l’obstacle permanent de l’hégémonie américaine et son intervention dans les affaires d’un monde menacé d’impuissance, de désordre et de déstabilisation. C’est au prix d’une contre-hégémonie, d’une contestation sur la domination que certains états peuvent espérer sentir leur poids dans la construction et la garantie de l’ordre mondial, et préserver leur identité face à l’américanisation croissante de la planète. Le moment est donc venu, et largement venu, d’imaginer les architectures nécessaires à l’achèvement de ce qu’il est convenu d’appeler la construction américaine.
Mots clés
Orient, Occident, Hégémonie américaine, Domination, Contre-hégémonie.
الملخص
إن تفسير التّطوّر الذي تشهده السّاحة الدّوليّة وفهم الواقع المتغير والمعقد في الشّرق والغرب بالتّفصيل وبدقة يعدّ مهمّة جريئة. فإلى جانب صعوبة احصاء المعطيات السّياسيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة ضمن إطار متماسك لتدارك تطور الأحداث، يبرز العائق المستمر المتمثّل في الهيمنة الأمريكيّة وتدخلّها في شؤون عالم مهدّد بالعجز والفوضى وزعزعة الاستقرار. فقط من خلال حركة مضادة للهيمنة ومن خلال الاعتراض على السّيطرة يمكن أن تتأمّل بعض الدّول أن تشعر بقيمتها في إعادة البناء وضمان النّظام العالميّ، والحفاظ على هويتها في مواجهة الأمركة المتزايدة حول العالم. لقد حان الوقت، بل حان لأقصى حد، لوضع الهياكل الضّرورية لتحقيق ما تم التّوافق على ان تُسمى بالبناء الأمريكي.
الكلمات المفتاحيّة: الشّرق، الغرب، الهيمنة الأمريكيّة، السّيطرة، مواجهة الهيمنة
J’ai toujours cru que ce continent était un lieu exceptionnel dont le destin était exceptionnel. Je crois que notre destin est d’être le phare d’espérance de l’humanité toute entière.
Ronald Reagan (Reagan cité par Allman, 1986, p.141)
Entre l’Orient et l’Occident existe, depuis l’Antiquité, une relation d’attraction-répulsion à tous les niveaux. C’est cette proximité ainsi que la fluctuation à travers les âges des frontières culturelles et politiques vis-à-vis de l’Orient qui expliquent l’ambivalence de la relation et l’intensité des préjugés et des passions. « L’intérêt de l’Europe, puis de l’Amérique pour l’Orient était certes d’ordre politique, comme le montrent certains faits historiques évidents, mais que la culture a créé cet intérêt ; c’est son action dynamique, jointe à de brutales raisons politiques, économiques et militaires, qui a fait de l’Orient cet objet varié et complexe.” (Saïd, 1980, p.24) Cet amalgame a gouverné depuis le début de ce siècle : les rapports de forces, de pouvoir et de domination entre l’Orient et l’Occident, l’hégémonie américaine sans partage, les passions politiques soulevées de part et d’autre par la décolonisation, la permanence du sous-développement et de l’humiliation en dépit de la richesse pétrolière, l’énormité des enjeux économiques et géopolitiques : tels sont les éléments de base qui permettent aux amalgames de contribuer à intensifier les situations conflictuelles et à aggraver l’instabilité de l’équilibre du monde.
La perception de cette réalité mouvante et complexe sera donc l’objectif de cet article. Nous nous sommes référés à l’ouvrage d’Amin Maalouf intitulé Le Labyrinthe des égarés. C’est un livre d’interprétation du vécu social et culturel- des pays de l’Occident, de l’Asie orientale, à savoir le Japon, la Chine, la Corée, ainsi que les pays qui appartiennent à la ligue des Etats arabes, tels le Liban, la Palestine, l’Égypte, l’Irak- replacé dans une perspective politique que nous cherchons à saisir, expliquer et interpréter. Nous ne nous étonnerons pas de constater que dans ce livre monumental et passionnant publié en 2023, chez Grasset et Fasquelle, l’Histoire tienne une large place. Maalouf ne prétend guère ignorer ses leçons. Il est précieux de relire ainsi ces mots significatifs : « Tel est le grand enseignement que nous prodigue l’Histoire, et il y a là peut-être, par-delà les tragédies d’hier et d’aujourd’hui, l’ébauche d’une solution. » (Maalouf, 2023, p.14) Ce n’est pas pour autant un livre d’histoire. Maalouf avoue.
Je me suis penché, dans cet essai, sur quatre grands pays dont les parcours singuliers ont contribué à construire le monde tel que nous le connaissons en ce siècle. Chacun d’eux s’est battu contre tous les autres, et aussi contre les vieilles puissances coloniales. Ils ont rêvé d’hégémonie, ils ont tous connu des victoires et des moments d’ivresse, avant de se brûler les doigts. Ils ont longtemps cherché à se détruire les uns les autres, et ils n’ont toujours pas surmonté leurs méfiances, leurs peurs et leurs ressentiments. S’ils décidaient demain de suivre leurs pires instincts, comme il leur est arrivé quelquefois de le faire au cours des cent dernières années, les conséquences en seraient dévastatrices. (Maalouf, 2023, pp423-424)
De même, cette œuvre propose, sous une forme accessible, la vision d’un monde qui soit autre que celle de l’irrationalité omniprésente à travers laquelle il se présente trop souvent. C’est une vision où cesseraient de dominer les puissances occidentales, pourrait aussi avec le temps devenir la réalité, si lointaine soit-elle, d’un Orient réconcilié avec l’Occident et avec lui-même, et d’un Occident réconcilié avec lui-même et avec l’Orient. Seules ces réconciliations permettront à l’humanité d’entrer « enfin dans l’âge adulte, et dont les différentes composantes éprouveraient l’envie de donner et de recevoir, d’influencer les autres et de s’en laisser influencer, sans humilier personne ni se laisser humilier. » (Maalouf, 2023, p.436) Ce mécanisme, défini par Maalouf comme une logique « de solidarité planétaire » (Maalouf, 2023, p.436) se révèle en tant que tel comme le seul moyen de « sortir parfaitement de ce labyrinthe. » (Maalouf, 2023, p.436 »
Comme point de départ, nous soulèverons tout un ensemble de questions qui se posent à bon droit quand nous parlons de « l’appétit géographique » (Saïd, 1980, p.247) de l’Occident et sa mission de régénérer l’Orient, comme l’enseigne Thomas Paine, l’un des pères fondateurs de générations de pionniers venus des quatre coins de la terre. De l’autorité européenne au monopole américain : nous ferons quelques pas dans le processus de ce que Raymond Williams appelle « l’esprit spontané de domination. » (Williams, 1958, p.376) Cette autorité sur l’Orient sera en grande partie le sujet de notre article. Cette force supérieure de l’occident passe des mains des européens couverts de ruine à celles des américains. Certes, il est question ici de « déclassement » (Maalouf, 2023, p.12) des puissances du vieux continent par rapport au rang qu’elles tenaient dans le monde au temps des grands empires coloniaux. Maalouf écrit de manière très suggestive :
Une bonne partie de leur prépondérance perdue a été « récupérée » par cette autre puissance occidentale que sont les Etats-Unis d’Amérique. La grande nation d’outre-Atlantique s’est hissée à la première place il y a plus de cent ans ; c’est elle qui s’est chargée de barrer la route à tous les ennemis de son camp ; et à l’heure où j’écris ces lignes, elle conserve sa primauté- par sa puissance militaire, par ses capacités scientifiques et industrielles, comme par son influence politique, culturelle et médiatique dans l’ensemble de la planète. (Maalouf, 2023, p.12)
Pour reprendre le titre d’un article prophétique de René Dabernat dans Le Monde du 27 octobre 1965, il n’y a plus qu’un supergrand (Dabernat cité par Fontaine, 1991, p.264). Si nous nous référons à ce nouvel ordre mondial, « le monde de l’immédiat après-guerre froide n’est pas multipolaire. Il est unipolaire. Le centre de la politique mondiale est la superpuissance incontestée, les Etats-Unis assistés [attended by] par leurs alliés occidentaux. » (Krauthammer, 1990-1991) Du coup, l’Amérique devient le temple même de la prospérité et la seule grande puissance qui puisse non seulement fonder et maintenir la paix et la démocratie dans le monde, mais surtout « règlementer les rapports internationaux. » (Fontaine, 1991, p.263) Qui ne rêvait d’un monde où pour reprendre les paroles de Georges Bush, « le règne de la loi, et non plus la loi de la jungle, gouverne la conduite des nations ? » (Bush, 1991) L’Amérique aura d’elle-même une vision qui sera celle, comme l’écrit le journaliste T.D. Allman « d’un législateur bienveillant apportant l’ordre, le bien et la liberté à un monde où règnent le chaos, le mal et l’esclavage ? » (Allman, 1986, p.144) Faut-il pour autant se résigner à voir un seul pays, fût-il désormais la seule superpuissance, décider du sort de tous ? De quel droit prend-il cet air de supériorité vis-à-vis des orientaux ? A voir toutes les injustices, toutes les violences, n’y a-t-il pas lieu de craindre que l’ordre annoncé ne débouche en fin de compte sur une nouvelle version de ce « désordre établi » (Domenach, 1972, p.50) dont parlait Emmanuel Mounier ? Comment en effet donner sens à cette réalité constamment jalonnée de coups d’Etat militaires, de referendums plébiscitaires, de révolutions, des mouvements de foules, du sang des attentats, de défaites militaires successives, de villes soumises à la destruction, de guerre civile et de terreur à travers lesquels Orient et Occident s’appréhendent l’un l’autre dans la grimace et la crispation ?
L’ambition de cette seule « superpuissance » (Fontaine, p.13) peut paraitre démesurée. Cependant, risquerait-elle aujourd’hui de tomber de son piédestal ? Assisterions-nous, tout au long de ce siècle, comme le prétend Maalouf, « au déclassement de l’Occident tout entier, et à l’émergence d’autres civilisations, d’autres puissances dominantes ? » (Maalouf, 2023, p.12) A défaut de prétendre répondre à toutes ces questions, cet article nous invite de repenser en profondeur la manière dont notre planète est gouvernée. Il nous invite ainsi, du même coup, à s’angoisser de cet égarement du monde afin de prendre nos responsabilités et préparer « pour les générations futures un avenir plus serein, qui ne soit pas fait de guerres froides ou chaudes, ni de luttes interminables pour la suprématie. » (Maalouf. 2023, p.13-14)
C’est donc pour rendre à ces évènements leur juste mesure, leur place dans l’évolution complexe et difficile des sociétés, que ces pages sont tentées. Elles le sont aussi pour mettre en perspective la relation de pouvoir et de domination entre l’occident et l’Orient, espèce d’autorité sur l’Orient qui se résume, selon Arthur James Balfour, par une théorie simple, précise et claire : « Il y a les Occidentaux et il y a les Orientaux. Les uns dominent, les autres doivent être dominés, c’est-à-dire que leur pays doit être occupé, leurs affaires intérieures rigoureusement prises en main, leur sang et leurs finances mis à la disposition des puissances occidentales. » (Saïd, 1980, p.50) Pour ce faire, nous avons choisi de tenter l’aventure d’une approche géopolitique prônée par Bertrand Badie s’efforçant de réactiver un concept vieux de vingt-cinq siècle, le « concept d’hégémonie » (Badie, 2019, p.11) et de nous renseigner, certes, sur « les vicissitudes et les illusions, peut-être les vices, qui accompagnent la démesure de l’hégémonie. » (Badie, 2019 p.23) Il s’agit là notamment de « la servitude volontaire et recherchée » (Badie, 2019, p.53) Dans son ouvrage L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale (2019), il étudie une nouvelle façon de construire l’international, il parle de la nouvelle hégémonie qui s’impose ou de « cette contre-hégémonie de défense contre le dominant » (Badie, 2019, p.121) aujourd’hui à la mode. Et Badie de préciser sa pensée en écrivant : « Comme si la vision systémique se refermait. Comme si le monde retournait à la parabole des boules de billiard, apparemment égales, prétendues libres, cherchant d’abord à cogner et à s’entrechoquer. » (Badie, 2019, p.21)
Pour cette étude de l’hégémonie ou de l’autorité, mes principaux outils méthodologiques sont l’approche sociologique préconisée par Pierre Bourdieu, notamment dans son ouvrage, Raisons Pratiques (1994) qui est une manière de décrire la construction du « monopole étatique » (Bourdieu, 1994, p.131) qui ne peut s’accomplir qu’au prix « d’une reconnaissance universelle de la représentation universaliste de la domination, présentée comme légitime, désintéressée » ( Bourdieu, 1994, p.131) et la soumission doxique « aux gouvernements les plus despotiques » (Bourdieu, 1994, p.128) au nom d’un « conformisme logique » (Bourdieu, 1994, p.103) qui s’impose durablement, naturellement et légitimement sous forme de « pieuse hypocrisie. » (Bourdieu, 1994, p. p33) Les théories d’Edward Saïd, notamment celles de « l’autorité » (Saïd, 1980, p.33) et ces attributs appliqués par l’orientalisme anglo-français, puis l’orientalisme américain sur l’Orient, dans son ouvrage l’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (1980) paraissent significatives.
Zone de confluences, de convergences et de divergences entre grandes civilisations, religions et empires politiques, l’Orient ne peut être saisi simplement. C’est en dessinant les rapports potentiellement explosifs qui lient la société orientale à la société occidentale que nous tenterons d’appréhender la dimension dramatique du nouvel épisode malheureux de la relation des orientaux à l’Occident qui s’ouvre avec le formidable nouvel ordre international : « Pour la première fois dans l’histoire, une seule puissance, les Etats-Unis, détient l’hégémonie mondiale. » (Fontaine, 1991, p.8) Nous tenterons par nos analyses de tracer la complexité des évènements, les profonds bouleversements, les traumatismes historiques connus par les sociétés orientales, mais aussi d’expliquer l’égoïsme, la soif exclusive de puissance de l’Occident enchanté d’exercer ce leadership qui, s’il flatte son amour-propre, met de plus en plus à l’épreuve sa compétence, sa lucidité et sa magnanimité qu’il n’a pas toujours eue.
I- Le combat Orient/ Occident : entre espérances et illusions
O Occident ! Ộ Orient ! rapprochez, regardez, reconnaissez, saluez, étreignez-vous ! […] Dieu tout-puissant et éternel ! […] Que votre souffle divin plane sur ces eaux ! Qu’il y passe et repasse, de l’Occident à l’Orient, de l’Orient à l’Occident ! Ộ Dieu ! servez-vous de cette voie pour rapprocher les hommes les uns des autres. (Lesseps, 1881, pp. 324-333)
1.Les opprimés de l’Orient
Les occidentaux n’ont pas attendu longtemps pour se sentir investis d’une mission. Aucun doute n’est possible, l’Occident disposé à prendre en main « la cause des populations souffrantes » (Saïd, 1980, p.249) a toujours été en position de domination. Sans pouvoir donner ici toutes les références de L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident (1980) où Edward Saïd aborde un tel sujet, il est précieux, malgré tout, de redire ce texte décisif : « La relation essentielle, sur le terrain politique, culturel et même religieux, a été considérée- en Occident- comme un rapport entre partenaires fort et faible. » (Saïd, 1980, p.55) Certes, il est encore question ici de distinction, mais à cette idée s’ajoute « l’indéracinable distinction faite entre la supériorité occidentale et l’infériorité orientale » (Saïd, 1980, p.57) qui est l’essence même de l’orientalisme.
Sous de tels cieux, les orientaux reproduisent « naturellement » (Bourdieu, 1994, p.128) selon un terme cher à Bourdieu, un ordre « sans le savoir, ni le vouloir. » (Bourdieu, 1994, p.47) Leurs actions « grossièrement orchestrées » (Bourdieu, 1994, p.47) correspondent essentiellement à une reconnaissance et adhésion naturelle et doxique au point de vue des dominants qui s’impose comme universel. Bourdieu écrira par exemple dans Raisons Pratiques (1994) ou le thème de la monopolisation est central : « la monopolisation ne peut être obtenue qu’au prix d’une soumission à l’universel et d’une reconnaissance universelle de la représentation universaliste de la domination, présentée comme légitime, désintéressée. » (Bourdieu, 1994, p.131)
Quand Maalouf choisit de dévoiler le monde par cet ouvrage, il nous invite à prendre nos responsabilités devant cet univers qu’il nous révèle. Il écrit : « nous aussi, nous sommes des Orientaux opprimés par les Occidentaux. » (Maalouf, 2023, p.52) Ou encore : « Nous, les Orientaux, on nous enseigne depuis l’enfance que notre civilisation appartient à un passé révolu, que nous n’avons aucun rôle dans le monde d’aujourd’hui, et que nous devons accepter la suprématie de l’Europe. » (Maalouf, 2023, p.52) Cette clairvoyance n’étonne pas sous la plume de celui qui eut toujours la persuasion et le courage obstiné de révéler que « les puissances occidentales portent une responsabilité dans les tragédies dont on a pâti, au cours des siècles, et dont on continue à pâtir » (Maalouf, 2023, p.431) Il écrit qu’il cherchait « un salut » (Maalouf, 2023, p.436) dans sa littérature qu’il se croyait « une manière d’instruire les nations et de leur montrer le chemin vers le progrès et la civilisation. » (Maalouf, 2023, p.52) et qu’il pensait avoir pour mission de « leur expliquer comment ont procédé ceux qui y ont réussi. » (Maalouf, 2023, p.52)
Ce qui frappe rétrospectivement dans ces évènements des derniers siècles, au-delà de l’aspect traumatisant des violences et des tensions les plus abrupts, c’est la récurrence des modernisations avortées et des discours révolutionnaires dans le monde entier, avec pour entreprise ambitieuse et optimiste de « libérer les peuples d’Orient, mettre fin à la division de l’humanité en peuples oppresseurs et peuples opprimés, et pour parvenir à l’égalité complète entre tous les peuples et les races, quelles que soient leur langue ou la couleur de leur peau, et quelle que soit la religion qu’ils professent. » (Maalouf, 2023, p.104) Cet appel est principalement un appel lancé par Karl Radek, une grande figure du Komintern, une invitation à une révolution russe libératrice et anticolonialiste. Le tableau révolutionnaire du congrès des peuples d’Orient organisé par le Komintern à Bakou, en septembre 1920, le montre assez. Dans le discours d’ouverture, Zinoviev déclare : « Prolétaires de tous les pays et peuples opprimés du monde entier, unissez-vous ! » (Maalouf, 2023, p.104) Si le poids des chaines de la servitude augmente considérablement, un appel solennel formulé par Lénine et Trotski cible plus l’attaque : « Que votre congrès apporte la force et la confiance aux millions d’êtres humains qui demeurent opprimés, partout dans le monde ! Qu’il leur insuffle la foi en leur propre puissance ! Qu’il rapproche le jour de leur triomphe définitif et de leur libération ! » (Maalouf, 2023, p.105)
Il aurait pourtant fallu y regarder de plus près, car les horreurs ne sont pas moins grandes du côté d’autres sociétés orientales. La Chine, pays qui a connu, « pendant des siècles, une humiliante décadence » (Maalouf, 2023, p. 183) et dont la souveraineté accompagnée d’une suite d’égarements, vient de s’affirmer dans l’ordre international, pourrait-elle « oublier les cent ans d’humiliation nationale qu’ils ont subis de la part des Anglais et de tous les Occidentaux, comme de la part des japonais et des Russes, à partir des années 1840 et tout au long du dix-neuvième et du vingtième siècle ? », écrit Maalouf dans Le Labyrinthe des égarés (2023). Et c’est parce que les chinois, comme toute race orientale, sont crédules, « dénués d’énergie et d’initiative » (Saïd, 1980, p.53), leur esprit manque singulièrement « de faculté logique » (Saïd, 1980, p.53), et pour la plupart, ils n’ont pas la connaissance infuse de ce qui est bon pour eux, que les occidentaux leur refusent « naturellement l’autonomie. » (Saïd, 1980, p.47) Saïd a montré que l’Orient doit être reconstruit et fabriqué par l’Occident car ce dernier « possède un savoir systématique croissant sur l’Orient, […] a toujours été en position de force et de domination, comme un rapport entre partenaires fort et faible. » (Saïd, 1980, p.55) Certes, il est question ici de de deux grands thèmes baconiens, au savoir s’ajoute le pouvoir c’est-à-dire « l’autorité de ce qui est la race dominante » (Saïd, 1980, p.49) sur une classe inférieure, dominée. Il écrit de manière plus claire encore.
Ils sont une race sujette, dominée par une race qui les connait, et qui sait ce qui est bon pour eux mieux qu’ils ne pourraient eux-mêmes le savoir. […] Ils n’ont d’utilité dans le monde actuel que parce que les Empires puissants et modernes les ont effectivement sortis de leur misérable déclin pour en faire les habitants réadaptés de colonies productives. (Saïd, 1980, p. 49)
Il fallait déjà citer ce passage de Maalouf, car il est exemplaire de la complexité des rapports entre la Chine et l’Occident, que nous avons évoquée dans le paragraphe précèdent, et à travers lesquels Orient et Occident se regardent. Cette complexité se révèle surtout dans la guerre de l’opium, « inaugurant, pour les Chinois, l’un des chapitres les plus sombres de leur longue histoire. » (Maalouf, 2023, p.209)
En un mot, le pays était pratiquement désarmé, et comme nu. […] Le trafic de l’opium prit très vite des proportions inouïes. Des 1820, la drogue était devenue le premier produit d’importation en Chine, et sa part ne cessait de croitre, vidant le pays de ses réserves d’argent et causant une grande détresse dans la population. Des millions d’habitants s’adonnaient à cette consommation, notamment parmi les élites, et au sein même de l’administration impériale. […] La Chine n’allait plus connaitre, pendant plusieurs générations, que des révoltes qui finissent mal, des reformes qui tournaient court, et des conflits armés qui se terminaient invariablement par de nouvelles humiliations. (Maalouf, 2023, pp210-211)
Il est évident que dans l’attaque de la Chine, la pensée de Saïd connait sa force. Il note très clairement : « connaitre un objet, c’est le dominer. » (Saïd, 1980, p.46) C’est là, en effet, que certains britanniques « découvrant le goût de la population locale pour l’opium, décidèrent de mettre en place une sorte de commerce triangulaire, infiniment plus lucratif que celui qui prévalait jusque-là. […] Et sans rien acquitter au Trésor impérial … » (Maalouf, 2023, p.203) Nous comprenons dès lors l’importance que revêt dans L’Orientalisme (1980) des questions telles que « celles de l’infériorité et de supériorité. » (Saïd, 1980, p.47) Nous ne mettons jamais en doute la supériorité anglaise ni l’infériorité chinoise, ce sont pour Saïd, selon son expression minutieusement choisie : « les conséquences du savoir » (Saïd, 1980, p.47) ou encore l’incapacité de « self-government » (Saïd, 1980, p.47) et la « déraison de l’Oriental. » (Saïd, 1980, p.55) Rappelons, en passant, que si Bourdieu parlait du champ de pouvoir pour désigner les rapports de force entre dominants/ dominés (Bourdieu, 1994, p.56), il lui serait facile d’énumérer les traits du style de vie des classes dominées qui enferment, à travers le sentiment de l’incompétence, de l’échec ou de l’indignité culturelle, une forme de reconnaissance des valeurs dominantes. » (Bourdieu, La distinction, 1979, p. 448). Saïd donne alors pour conclusion à son raisonnement ces lignes significatives.
L’esprit de l’Oriental manque au plus haut point de symétrie. Sa manière de raisonner est pleine de laisser-aller. [Ils] manquent singulièrement de faculté logique. Ils sont souvent incapables de tirer les conclusions les plus évidentes de prémisses simples dont ils peuvent accepter la validité. Leurs explications sont prolixes et manquent de clarté. (Saïd, 1980, p.53)
Maintenant, est-ce un bien pour une nation civilisée comme la Grande-Bretagne, placée en situation de suprématie sur un pays de l’Orient, comme « le géant de l’Asie ? » (Maalouf, 2023, p. 186) Nous pensons que c’est un mal. Il suffit de relire la réponse très imagée de Victor Hugo au correspondant britannique, le capitaine Butler, après la victoire commune remportée en Chine par la France et la Grande-Bretagne :
« Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d’Eté. L’un a pillé, l’autre a incendié. Et l’on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l’histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous les chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. L’Empire français a empoché la moitié de cette victoire, et il étale aujourd’hui le splendide bric-à-brac du palais d’été. J’espère qu’un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. » (Maalouf, 2023, p.214)
Tout ce qui se passe montre que les grands Etats, à l’époque, sont autant d’ogres qui ne rêvent, selon le cas, que de revanche ou de conquêtes par le sang ou par le fer. Leur supériorité et antipathie s’étend à tout l’Orient. Ils ne comprennent pas qu’ils ne s’agrandissent qu’à leurs propres dépens. « Les misérables Européens ont mieux aimé jouer aux Armagnacs et aux Bourguignons que de prendre sur toute la Terre le grand rôle que les Romains surent prendre et tenir pendant des siècles dans le monde de leurs temps », dira Paul Valéry. (Valéry, 1945, p.34)
- Egoïsme et puissance de l’Occident
L’Occident, bien sûr, peut mieux se défendre. La société développée est en effet celle qui par son accumulation de savoir et de pouvoir (Saïd, 1980, p.46) intériorisée dans l’ordre du monde tout entier, sait transformer les épreuves qu’elle doit affronter en nouvelles sources de savoir et de pouvoir. Bourdieu parle excellemment dans La domination masculine (2002) de « la doxa ou de l’ordre du monde établi avec ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses interdits » (Bourdieu, 2002, p.11) qui impose indiscutablement « cette certitude de soi, cette arrogance qui, étant d’ordinaire le monopole des [sociétés] les plus assurées du rendement de leurs placements, ont toutes les chances, dans un univers où tout est affaire de croyance, d’imposer leurs investissements comme les plus légitimes, donc les plus rentables », (Bourdieu, 1979, p.136) écrit d’une manière plus claire dans La Distinction (1979). L’Orient, au contraire, est celui dont même les avantages et les sources potentielles de puissance deviennent des causes de faiblesse additionnelle, de dépendance accrue et de déséquilibres nouveaux. C’est pourquoi, en Occident, la crise pétrolière est à l’origine de nouveaux progrès techniques dans tous les domaines énergétiques, de réajustements industriels, rendus en tout cas nécessaires du fait des changements profonds dans la compétition technique et économique que se font entre eux les grands pays capitalistes. En Orient, la tyrannie pétrolière, nouveau fléau des orientaux, « détruit dans le désordre le tissu social, crée des déficits alimentaires graves et une dépendance quasi-totale sur la production pétrolière, mettent des économies squelettiques dans une situation d’extraversion totale vis-à-vis des pays développés, en particulier occidentaux, et donc dans une position de vulnérabilité absolue » (Corm, 1991, p.180), écrit Georges Corm dans Le Proche-Orient éclaté (1991). Une page plus loin, il évoque en termes réalistes et poignants l’inflation que connaissent les pays orientaux, le chômage, le chaos, l’effondrement, et « la marginalité sociale et économique qu’accélère le pétrole dans les pays orientaux, pour tous ces ruraux, petits artisans, petits fonctionnaires, qui ne peuvent suivre ni le rythme d’inflation, ni les changements brutaux et chaotiques que connait leur paysage culturel, économique et social. » (Corm, 1991, p.181)
Dans ce combat, Saïd reconnait que l’oriental est « un fournisseur de pétrole. » (Saïd, 1980, p.320) Il considère, en effet, que cette réalité est une caractéristique négative puisqu’elle l’enchaine « à une destinée qui le fixe et le condamne à une série de réactions châtiées par l’épée terrible et rapide » de l’Occident. Et si les pays orientaux pétroliers sont bel et bien enfermés dans un cercle vicieux, c’est qu’ils sont dépourvus « de toute qualification morale à posséder de si grandes réserves de pétrole. » (Saïd, 1980, p. 320) En rattachant aussi fortement, dans L’Orientalisme, L’Orient créé par l’Occident (1980) le stéréotype oriental “à une caricature classique le montrant comme l’image même de l’incompétence et de la défaite » (Saïd, 1980, p. 319) et dont se dégage cette impression de violence, de débauche de bassesse et de « malhonnêteté sanguinaire » (Saïd, 1980, p.320) qui nous gagne peu à peu, Saïd passe à l’idée que les occidentaux « pourraient envahir les champs de pétrole orientaux et arabes. » (Saïd, 1980, p.320) Pire encore, cette domination se maintient « tout autant par le consentement des Orientaux que par une pression économique directe et brutale » (Saïd, 1980. P.349 » des pays Occidentaux, affirme Saïd en dévoilant la domination imposée et subie au nom « d’un principe symbolique connu et reconnu par le dominant comme par le dominé. » (Bourdieu, 2002, p.12 » Des pages très révélatrices résument, chez Bourdieu (2002) les conditions d’existence les plus intolérables qui apparaissent pourtant comme naturelles et même acceptables. Bourdieu parle de « la violence symbolique » (Bourdieu, 2002, p.12 » ou encore du « pouvoir hypnotique de la domination. » (Bourdieu, 2002, p.12) Dans Le Labyrinthe des égarés (2023) Maalouf consacre une dizaine de page au thème du drame de la crise pétrolière et à l’absence de dialogue sérieux sur le plan du développement, et dont l’Occident porte une grande part de responsabilité. Il écrit.
En Iran, par exemple, le Dr Mossadegh, un éminent juriste qui avait été démocratiquement élu à la tête du gouvernement, voulait que son pays exerce sa souveraineté sur ses ressources pétrolières, jusque-là contrôlées par les Britanniques, qui ne laissaient aux Iraniens que des miettes. […] Le président Dwight Eisenhower, entra à la Maison Blanche en 1953, il reçut la visite de Winston Churchill, venu lui expliquer que Mossadegh était, en vérité, une marionnette aux mains des communistes. Pour faire face à ce « péril », on chargea la CIA d’organiser un coup d’Etat, déguisée en soulèvement populaire, qui renversa le gouvernement légal et redonna aux Occidentaux, pour vingt ans, le contrôle du pétrole iranien. (Maalouf, 2023, pp.384-385)
Pourquoi donc cette hostilité entre les puissances occidentales et l’Orient ? Pourquoi affronter éternellement l’Orient, son désordre, ses excentricités, sa barbarie, et le tenir en échec pour le compte de l’Occident ? Pourquoi dire non à la « clause d’égalité » (Maalouf, 2023, p. 68) qui reconnait la souveraineté des pays orientaux sur les anciennes possessions occidentales au lendemain de la Première Guerre mondiale ? C’est parce que les chancelleries du vieux continent, selon Maalouf, se méfiaient beaucoup de ses implications. (Maalouf, 2023, p.67) Maalouf se demande ainsi dans Le Labyrinthe des égarés (2023) que « si l’on admettait que les peuples d’Asie et d’Afrique étaient les égaux des européens, au nom de quoi les Britanniques, les Français, les Belges ou les Néerlandais pouvaient-ils continuer à les coloniser ? » (Maalouf, 2023, p.67) La thèse fameuse selon laquelle la conscience que l’Occident a actuellement de l’Orient, c’est de maintenir cette région et ses habitants dans des concepts qui les châtrent, de les réduire à des attitudes, à des tendances, à des statistiques : bref, de les déshumaniser (Saïd, 1980, p.325), il est bon de la situer au niveau de l’œuvre de Maalouf. Cette dernière, en effet, tend à la confirmer, nous rappelle que les occidentaux connaissent la nature traitresse des orientaux, leur intelligence superficielle, leur déséquilibre, leur faiblesse d’esprit, leur dépravation, ainsi que leur agressivité qui provient « d’un réservoir d’excentricité infinie. » (Saïd, 1980, p.123) Cette connaissance se traduit en déception, et « cette déception se traduit en rancune d’un bout à l’autre de l’Orient et la rancune est tout près de se convertir en haine » (Saïd, 1980, p.279), une mauvaise foi, un refus assez révoltant qui se traduit dans ces lignes significatives.
De plus, les Etats de la côte pacifique, notamment la Californie, connaissent en ce temps-là une hostilité croissante à la venue d’immigrants asiatiques, constamment décrits, par la presse et par les politiciens, comme un « péril jaune », et tout ce qui tendait à leur reconnaitre des droits similaires à ceux des Européens était perçu avec méfiance. Cette attitude rejoignait celle de certains membres du Commonwealth britannique, telle l’Australie, qui était terrorisée à l’idée de voir débarquer sur ses côtes des foules de migrants venus d’Asie. (Maalouf, 2023, p.67)
Une telle analyse est incontestablement vérifiée en évoquant les itinéraires des affrontements qui opposent l’occident à ses adversaires chez Maalouf. Pourtant des questions s’imposent : Pouvons-nous demander à L’Occident ce qu’il ne peut pas donner ? Le chapeau européen qui a fait sa règle du « diviser pour régner » (Fontaine, 1991, p.280) pourrait-il gouverner éternellement la conduite des nations ? Les américains fort enthousiastes le feraient-ils à leur place ? Persuadés de leur supériorité morale uniraient-ils le genre humain comme une grande famille par des liens fraternels ? La semence d’union et de libertés qu’ils avaient jetée, germerait-elle peu à peu dans toute la terre ?
- Changement de décor : la polarisation des contradictions
- Le nouvel ordre : L’hégémonie américaine
L’histoire de l’humanité a commencé par une ère méditerranéenne, elle a continué par une période atlantique et elle entre dans une phase du Pacifique. (L’Huillier, 1954, p.266)
C’est dans une lettre à La Fayette que Washington s’est exprimée là-dessus où ce qui est souvent le cas, la candeur fait bon ménage avec la présomption : « Les Etats-Unis seront les législateurs de toutes les nationalités » (Voyenne, 1964) Rappelons, en passant, que Charles Wilson, dira pratiquement la même chose : « Ce qui est bon pour les Etats-Unis est bon pour le monde. » (Julien, 1968, p.238)
Il nous faut en effet dévoiler l’idée de « good nation » (Badie, 2019, p.170) ou de « benign leader » (Badie, 2019, p.170) évoquées par les discours de Georges Bush qui préconisent la mission « d’une domination dévouée » (Badie, 2019, p.170) ou « d’un hégémonisme fonctionnel et réparateur. » (Badie, 2019, p.170) Il ne fait pas de doute que le peuple américain « conçoit ordinairement sa mission dans le monde comme une source perpétuelle d’émancipation, délivrant chacun de toute forme de domination, au lieu de l’assimiler à une conquête hégémonique », reconnait Badie dans L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale (2019). Il se vante de « n’avoir jamais été une puissance coloniale au sens formel du terme, il a beau jeu de dénigrer la pratique conquérante des vieilles puissances européennes » (Badie, 2019, p.170), et qu’historiquement, « il en fut le premier pourfendeur. » (Badie, 2019, p.170) Nous pourrons encore citer, à ce sujet, la note de Michel Crozier : « Pour la majorité des américains, Dieu est de leur côté, parce qu’ils sont eux-mêmes du côté du Droit. […] Ils ont tout bonnement décidé de ne pas croire au mal, et éprouvent une passion pour la bonté de l’homme, pour la liberté assurée par contrat, pour le droit à la poursuite du bonheur. » (Crozier, 1980, pp. 258-262) C’est ce que Fontaine désigne par « la bonne conscience » (Fontaine, 1991, p.260) du leadership américain qui, non seulement « pouvait faire ce qu’il voulait, avec ou sans consensus » (Maalouf, 2023, p.399), et « quand sa formidable machine est en mouvement, il ne sert à rien de lui barrer la route, ni de chercher à la retenir » (Maalouf, 2023, p.400) mais aussi « face à une Europe incorrigible dans ses prétentions impériales » (Badie, 2019, p.171), règnera désormais selon la loi : « the rule of the law » (Fontaine, 1991, p.260) dont bénéficiera la terre entière.
Du coup, l’idée de règlementer les rapports internationaux, « sans aucune revendication territoriale » (Maalouf, 2023, p.356), refait surface précisément avec la fin de la guerre froide. A vrai dire, il s’agit « d’un nouvel ordre mondial, les Etats-Unis considèrent comme leur droit, et sans doute leur devoir, de se mêler de tout ce qui agite le vaste monde. » (Fontaine, 1991, p.269) Et si comme l’écrit Thomas Paine, « la mission du nouveau monde est de régénérer l’ancien » (Paine, 1984, p.23), n’était-ce pas le moment adéquat de reconstruire le monde, de le repenser différemment, ou selon un terme cher à Fontaine, de « l’américaniser ? » (Fontaine, 1991, p.270)
L’évidence est là : jamais nation n’a été aussi près de dominer le monde. « L’hégémonie qui se dessine, au lendemain du second conflit mondial, est bien celle qui dérive d’une exceptionnelle capacite économique et surtout d’une maitrise incontestée du commerce international » (Badie, 2019, p.13), reconnait Badie. Dans Le Labyrinthe des égarés (2023) Maalouf parle des Etats-Unis d’Amérique qui « symbolisent, mieux que quiconque, la nouvelle vision du monde qui était entrain d’émerger. Ils étaient, de par leur histoire, une extension de l’Europe ; mais ils avaient dû, eux aussi, se battre contre les empires européens pour obtenir leur indépendance. Et ils avaient réussi à construire, en peu de temps, une nation moderne, industrialisée, puissante, dynamique et prospère. » (Maalouf, 2023, p.357) Ailleurs : « Ils représentaient, de ce fait, un exemple, une inspiration, un modèle à suivre, et un allié potentiel pour tous ces peuples qui commençaient à se réveiller. » (Maalouf, 2023, p.357) Nous comprenons les paroles du président Wilson devenu « un prophète qui annonçait à la terre entière la naissance d’un ordre mondial plus équitable, plus moral, plus humain » (Maalouf, 2023, p.357), qui sonnaient « aux oreilles des opprimés » (Maalouf, 2023, p.358) comme l’expression de « la parfaite harmonie entre mondialisation et réalisation d’un rêve hégémonique et moralisant. » (Badie, 2019, p.173)
« Aucune paix ne peut durer, ni ne mérite de durer, disait-il, si elle ne reconnait et n’accepte le principe selon lequel les gouvernants dérivent tout leur pouvoir légitime du consentement de ceux qui sont gouvernés, et que personne n’a, nulle part, le droit de transférer les peuples d’une souveraineté à l’autre comme s’ils étaient des propriétés. […] Ces peuples devaient prendre leurs décisions sans être contraints, ni menacés, ni terrorisés ; les plus petits au même titre que les plus grands et les plus puissants. » (Maalouf, 2023, p.358)
Cette affirmation rend crédible le principe de « l’autodétermination » (Maalouf, 2023, p. 356), formulé par le président Wilson qui orchestre toutes les confiances à l’égard « d’un ordre mondial et des vertus d’un leader bienveillant. » (Badie, 2019, p. 21) C’est là que Maalouf expose longuement une notion importante ; il s’agit de la puissance hégémonique des Etats-Unis qui règneront désormais sur tous les autres par la force, l’influence, l’attraction et la persuasion.
De l’Inde à l’Afrique du Nord, et les Balkans jusqu’en Extrême-Orient, des patriotes jusque-là inaudibles commencèrent à se manifester. Souvent éduqués dans des écoles fondées par les Occidentaux, ils disaient que le moment était venu, pour leurs nations trop longtemps bafouées, de sortir de leur léthargie, de recouvrer leur dignité, et d’établir avec ceux qui les avaient soumis des rapports moins inégalitaires. […] L’humanité semblait sur le pont d’entrer dans une ère de réconciliation et d’harmonie ; et tout portait à croire que cette évolution allait se produire sous l’autorité morale des Etats-Unis d’Amérique. (Maalouf, 2023, pp.356-357)
Depuis lors, l’Amérique est conçue comme « la seule grande puissance qui puisse maintenir la paix dans le monde. » (Roosevelt, 1947, p.162) Elle a, du même coup changé le cours de l’Histoire. « Plus encore, le modèle américain s’impose », écrit Badie (Badie, 2019. P.52). L’hégémonie culturelle, consumériste, ludique, linguistique, économique et militaire ne faisait pas de doute. « Pour les Chinois, les Indiens, les Coréens, les Egyptiens, et tant d’autres, l’Amérique apparait comme le parrain et le garant de l’avenir qu’ils espéraient. Elle seule semblait capable de poser les fondements d’un nouvel ordre mondial, et de l’imposer aux récalcitrants » (Maalouf, 2023, p.358), affirme Maalouf dans Le Labyrinthe des égarés (2023).
Les américains avaient fondé, au-delà des mers, une nouvelle Rome. Avec une présidence impériale, un goût prononcé pour les arguties juridiques, un équilibrage subtil entre les différentes branches du gouvernement, et un Sénat installé sur la colline du Capitole. Bientôt leurs armées seraient en mesure de sillonner les routes de tout le monde connu, comme faisaient jadis les légions romaines ; sauf que le domaine de celles-ci n’allait pas beaucoup au-delà du pourtour méditerranéen, alors qu’à l’ère américaine, le monde connu couvre la terre entière, et lorgne vers la Lune, voire Mars. (Maalouf, 2023, p.407)
Si en ce temps-là, une telle conviction était répandue largement, pourquoi les Etats-Unis ont-ils participé à des guerres longues et sanglantes en Corée et en Indochine, mené des actions ouvertes ou secrètes sur une série de points chauds, soutenu des régimes corrompus ou dictatoriaux de l’Afghanistan à l’Afrique australe et à l’Amérique centrale, et surtout écrasé l’Irak sous les bombes ? Les apparences qu’ils avaient tenues étaient-elles trompeuses ? Le rôle visible de libérateurs suffit-il pour créer un statut d’hégémon ? La protection avait-elle un prix ? Dans son ouvrage L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale (2019), Badie a mis les choses au point dans sa formule désormais fatale et dramatique « désillusions hégémoniques. » (Badie, 2019, p.43) Cette formule éclaire ce qu’il appelle la nature trompeuse et aporique de l’hégémonie messianique (Badie, 2019, p.43) ; ayant découvert « des traces de soumission subie plus que désirée, d’imitation forcées plus que convaincues. » (Badie, 2019, p.53) Il note encore très clairement.
La mécanique de la nouvelle hégémonie, construite après 1945 par les Etats-Unis […] fut conçue avec suffisamment de soin pour créer les conditions nécessaires pour être désirée, réclamée […] L’intervention de l’arme atomique et son usage en aout 1945, y furent pour beaucoup : détenir seul une arme de destruction massive rend soudain votre protection aimable et désirable, surtout lorsque l’adversaire potentiel, de plus en plus menaçant, est réputé sur le point de la détenir à son tour. » (Badie, 2019, p.53) Ces lignes ne sont jamais restées étrangères à la pensée de Maalouf. Il écrit, par exemple.
Ce fut longtemps le cas en Afghanistan, où l’on suscita et encouragea une révolte jihadiste contre l’Union soviétique, qui affaiblit considérablement cette dernière et contribua à son effondrement ; sans se soucier du fait que cette mouvance, une fois déchaînée, allait se retourner avec hargne contre l’Amérique elle-même, et lui causer, sur son propre territoire, de très sérieux tourments. (Maalouf, 2023, p.387)
Cela étant dit, Maalouf a expressément poursuit sa réflexion en insistant sur « l’exceptionnelle dualité internationale » (Badie, 2019, p.56) entre l’Amérique et son « Co- hégémon » (Badie, 2019, p.53), la Russie construite sur « un mélange complexe d’inimitié schmittienne et de connivence machiavélienne. » (Badie, 2019, p.56) Cette dualité est définie comme une hégémonie trop étrange pour s’imposer longtemps car « lorsque l’un deux s’imposait dans un pays, l’autre parvenait à en contrôler le jeu contestataire et menaçait ainsi de le déstabiliser » (Badie, 2019, p.53) De cette hégémonie bipolaire, partagée ou croisée, Maalouf témoigne.
Dans tous les conflits et toutes les crises que connaissait la planète, on décelait désormais, d’une manière ou d’une autre, les reflets de l’affrontement central entre « l’Est » et « l’Ouest », le communisme et le capitalisme. Et comme les principales puissances des deux camps, notamment l’Union soviétique et les Etats-Unis, s’efforçaient d’éviter que leurs forces armées se combattent directement, on a pris l’habitude de parler d’une guerre « froide ». Mais c’était bel et bien une guerre, impitoyable, intense, incessante, globale, et elle n’était pas « froide » partout. Certaines de ses batailles ont fait des centaines de milliers de victimes, comme en Corée, en Indochine, en Indonésie, en Afghanistan, au Proche-Orient, en Amérique latine ou en Afrique Australe. (Maalouf, 2023, p.381)
A vrai dire, écoutons cette confidence renversante de Roosevelt : « la Russie se méfie de nous et nous rend méfiants à son égard » (Roosevelt, 1947, p.162) Et si les Etats-Unis détenaient le monopole de l’arme atomique qui faisait d’eux, au jugement de Truman, au lendemain d’Hiroshima, « la nation la plus puissante du monde, la nation la plus puissante peut-être de toute l’Histoire » (Truman, 1945), comment remettre en cause « cette absolue domination néolibérale » (Badie, 2019, p. 109) qui contribue à fragiliser l’URSS ? Cela étant dit, Maalouf dira pratiquement.
Les deux doctrines rivales s’appuyaient sur des principes universels parfaitement honorables. […] L’échec de l’Union soviétique n’a pas été uniquement causé par les manigances du camp adverse, mais par la faillite du modèle qu’elle prétendait construire. […] Le dirigisme de l’Union soviétique qui se prétendait rationnel, n’a produit que l’inefficacité, l’absurdité et le chaos. Le pouvoir communiste a laissé se développer au sein de la population le découragement, le cynisme, et une méfiance généralisée envers les dirigeants, leurs discours, leurs croyances et leurs promesses. (Maalouf, 2023, p.382)
Gardons-nous cependant de trop prolonger les courbes. Ce qui est vrai aujourd’hui c’est la préoccupation des Etats-Unis à remettre en cause mécaniquement les nouvelles formes d’hégémonie. Ils considèrent que « Dieu est de leur côté » (Fontaine, 1991, p.260), agissent en fonction « de leurs propres intérêts, […] et ils ont l’ambition d’être l’unique superpuissance. » (Maalouf, 2023, p.397) Cependant, cette vertu changerait-elle ? Les rapports s’inverseront-ils ? l’hégémonie restera-t-elle un état ou deviendra-t-elle désormais un cycle ? A mesure que nous progressons dans le III e millénaire, une contre-hégémonie l’emportera-t-elle sur l’hégémonie, la domination et l’adhésion consentie à « un supergrand », pour reprendre le titre d’un article prophétique de René Dabernat dans le Monde du 27 octobre 1965, à une nation qui domine le monde sans partage ?
- La rancune orientale : L’hégémonie ratée
La puissance américaine est sans commune mesure. Elle se fait « l’instrument privilégié d’un pouvoir qu’elle disposait aussi de l’assentiment souvent sincère, mais fabriqué du dominé. » (Badie, 2019, p.72) Il est intéressant de constater que le philosophe français La Boétie, affirme : « Dès que la conquête ne portait plus sur le territoire, mais sur les âmes, elle s’alimentait en effet des trois ressources : l’habitude d’être asservi, les drogueries qu’on distribue à cette fin, la cupidité du petit qui entend ressembler au puissant et bénéficier de ses récompenses. » (La Boétie cité par Badie, 2019, pp.71-72) Dans Le Labyrinthe des égarés (2023), Maalouf actualise cette hypothèse des trois médiations, et montre « la complexité des stratégies serviles » (Badie, 2019, p.72) déployées par une élite centrale qui ne s’agrandit qu’aux dépens de la « la sujétion des masses » (Badie, 2019, p.72) qui sombre dans le désespoir, baigne dans la régression, dans la haine, dans la rancœur des autres et dans la rancœur de soi. Le moins que nous puissions dire, au sujet de ce puissant hégémon, ces mots pour le moins suggestifs : « Ce qui est navrant, s’agissant de l’Amérique, c’est qu’il avait suscité d’immenses espérances, et qu’il avait déçu ses victimes. En partie par la faute des dirigeants des autres nations, de leurs avidités comme de leurs frayeurs. » (Maalouf, 2023, p.368)
Maalouf, dans le présent ouvrage, a démontré de manière très détaillée la déception des acteurs qui ont placé en l’hégémon tous leurs espoirs. Il parle de « grave malentendu » (Maalouf, 2023, p. 360), d’« injustices » (Maalouf, 2023, p.365), des « mêmes espérances suivies des mêmes illusions. » (Maalouf, 2023, p.364) A la lecture de tels vocables, nous comprenons que cette fameuse hégémonie qui « revendiquait le rôle ambitieux de solution universelle comme garant de la souveraineté d’un monde organisé et hiérarchisé » (Badie, 2019, p. 8), sera ce mal qui menace l’humanité de déstabilisation, de désordre et d’impuissance. « C’était là, pour les Etats-Unis, ce que la langue anglaise appelle, pudiquement, a mixed blessing, un euphémisme qui laisse entendre qu’à la bénédiction apparente est mêlée une malédiction cachée » (Maalouf, 2023, p.400), rappelle Maalouf. Plus loin, des images à méditer.
Ce que les Etats-Unis avaient admirablement réussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Europe occidentale avec le plan Marshall, et au Japon avec la « thérapie de choc » du général MacArthur, n’a jamais pu être reproduit. Chaque fois que les Etats-Unis s’y sont essayés, ils ont montré leur incompétence. Sans doute n’avaient-ils pas suffisamment d’estime pour les populations locales pour chercher véritablement à les moderniser, ni pour prendre au sérieux leur aspiration réelle à la démocratie. Bien des occasions furent ainsi perdues. (Maalouf, 2023, p.400)
Ce drame montre le « vide stratégique, les crises livrées à elle-même » (Badie, 2019, p.8), dira même Badie. Le cas le plus complexe est celui de Bagdad. En l’occurrence, « la victoire militaire éclatante et l’écroulement du dictateur irakien ont placé dans les mains des Américains un pays qu’ils devaient reconstruire, et remettre sur pied, ce dont ils se sont révélés incapables. Ils n’avaient rien prévu, rien préparé. Ni pour l’Irak, ni pour les autres pays où ils ont jugé utile d’intervenir dans les dernières décennies. » (Maalouf, 2023, p.400) Il s’agit une fois encore d’une démonstration qui serait convaincante : le fiasco d’une hégémonie que nous croyions prometteuse à où elle n’était que flatteuse.
Cela étant dit, l’Amérique, dans son rôle d’incontestable stabilisateur, continue « à écrire l’histoire, même si elle le fait maladroitement, voire dramatiquement, et souvent avec la main de l’échec. » (Badie, 2019, p.16) Qui trop embrasse, mal étreint. L’un des épisodes les plus révélateurs de sa politique désabusée et de ses pratiques les plus dangereuses ou les plus douteuses, c’est sa longue mésaventure en Afghanistan. Maalouf écrit en effet.
Quand ils se sont retirés de ce pays, fin aout 2021, d’une manière passablement chaotique, les responsables américains ont expliqué qu’ils avaient fait de leur mieux, et ils en étaient certainement convaincus. Leurs arguments paraissaient, d’ailleurs, irréfutables : l’Amérique a dépensé, dans ce pays, près de mille milliards de dollars en vingt ans, pour un résultat nul. […] On aurait pu penser que, les Etats-Unis, désireux de gagner « les cœurs et les âmes » des populations concernées, allaient développer un réseau d’écoles et d’universités ; des routes, des autoroutes, des gares, des aéroports ; et aussi des entreprises dynamiques, avec des usines, des fermes mécanisées, des laboratoires, des réseaux de distribution, etc. Qui mieux que la grande Amériques, pouvait opérer une telle modernisation […] ? Mais la superpuissance s’est cantonnée, hélas dans une vision purement sécuritaire du conflit, et elle s’est condamnée à l’échec. Le mouvement islamiste, qui avait été, initialement, vaincu et déconsidéré, a peu à peu regagné du terrain, ce qui a mené au cataclysme de 2021. Et l’Afghanistan se retrouve aujourd’hui sous la botte du gouvernement le plus rétrograde de la planète, après avoir eu pour mentor le pays le plus avancé. Un lamentable échec ! Une tragédie ! Une honte ! (Maalouf, 2023, p.394)
Nous avons beau multiplier les exemples des échecs si lamentables des Etats-Unis dans la gestion de certains dossiers cruciaux, au point de, selon Maalouf, « mettre en péril sa démocratie, son modèle de société, sa stature morale et sa place dans le monde. » (Maalouf, 2023, p.345) Maalouf a analysé avec perspicacité cet énorme ratage dans un « survol rapide d’une humanité à la dérive. » (Maalouf, 2023, p.345) Et dans ce gigantesque malentendu que nous donnons la parole à Badie qui s’exprime dans des termes qui rappellent étrangement ceux de Maalouf dans la présente œuvre : « Et qui serait assez naïf pour penser que l’hégémonie américaine était uniformément perçue comme aimable ? » (Badie, 2019, p. 19) Ou encore : « Et si le mythe de l’hégémonie américaine s’inversait ? » (Badie, 2019, p.89) Nous comprenons dans quel sens un comportement contestaire s’introduit et recompose désormais le nouvel espace mondial. Une contre-hégémonie, à la mode aujourd’hui, prend sa revanche. « Le populisme, en plein essor, qui orchestre toutes les méfiances à l’égard d’un ordre mondial et des vertus du leader bienveillant. Le néonationalisme, enfin, qui réintroduit le comportement du cavalier solitaire, tant chez le petit qui se prend de rêves de défi, que chez l’hégémon lui-même qui dénonce un dévouement qui, à ses yeux, lui a beaucoup trop coûté » (Badie, 2019, p.21), écrit Badie. Il revient sur cette idée fondamentale beaucoup plus loin dans le même ouvrage et affirme : « L’hégémonie produit moins un ordre qu’elle n’engendre le désordre, des tensions et surtout, de plus en plus de la contestation. L’importance du phénomène est telle que l’hégémonie est de nos jours dépassée par la contre-hégémonie. » (Badie, 2019, p.20) Une telle affirmation dessine en même temps de manière très claire les contours de ce nouveau concept, de cette étrange approche, de cette évolution du système international que Badie saisit ainsi de manière incontestablement surprenante : « nous verrons, à travers le temps, que la pratique d’hégémonie est particulièrement tiraillée, sollicitée et reconstruite. […] Mais nous verrons surtout un retournement qui est en train de bouleverser l’histoire. » (Badie, 2019, p.20) Il éprouve avec horreur le cercle vicieux de la satisfaction des « big men et des warlords » (Badie, 2019, p. 101), dénonce tout projet, prétention ou forme hégémonique, et plaide pour « un nouvel imaginaire spatial qui va mettre à mal l’uniformité du monde et donc les modes de domination à venir. » (Badie, 2019, p.93)
Il est impossible de conclure ce chapitre sans rappeler que Maalouf, dans sa volonté de capter le spectacle mondial dans sa totalité, s’est aussi profondément penché sur le parcours de contrées aussi différentes qui militaient pour « une renaissance de la civilisation asiatique. » (Badie, 2019, p.93) Une nouvelle fédération asiatique qui regroupe trois histoires impériales -le Japon, la Chine, la Corée- s’inscrit « dans un militantisme critique directement dirigé contre l’hégémonie occidentale. » (Badie, 2019, p.93) Badie parle alors de « panasiatisme » (Badie, 2019, p.93) qui est d’abord et surtout une revendication contre un Occident asservissant et dominateur. Là encore, l’histoire de ces pays est rigoureusement parallèle à celle de l’Amérique. Le Japon prétend appartenir à une « race de seigneurs » (Fontaine, 1991, p.311) devant qui tout devait s’incliner. La Chine demeure « à la fois un Etat et une civilisation millénaire » (Maalouf, 2023, p.410) rappellent ses dirigeants. La Russie fascinée par l’enseignement de Hegel ambitionnait de transformer le monde. Nous aurions pu craindre dans ces conditions que le vertige du succès rend arrogant « ces tigres aux dents atomiques » (Khrouchtchev cité par Fontaine, 1991, p.59) et finiraient du coup « à perdre la tête et compromettre ainsi le bénéfice des réalisations » (Maalouf, 2023, p.389) qu’ils avaient su accomplir. Avant de retrouver la démonstration maaloufieene, qui constitue d’ailleurs, le cœur de Le Labyrinthe des égarés, L’Occident et ses adversaires (2023), il nous faut reprendre la formule de Fontaine : « Naviguer sans carte est décourageant. » (Fontaine, 1991, p, 327) Dans la mesure où, selon Maalouf, ces puissances orientales ont tous rêvé d’hégémonie, ils se sont respectivement brûlés les doigts.
Ils ont tous connu des victoires et des moments d’ivresse. […] Ils ont longtemps cherché à se détruire les uns les autres, et ils n’ont toujours pas surmonté leurs méfiances, leurs peurs et leurs ressaisissements. S’ils décidaient demain de suivre leurs pires instincts, comme il leur est arrivé quelquefois de le faire au cours des cent dernières années, les conséquences en seraient dévastatrices. (Maalouf, 2023, p. 424)
Maalouf écrit ce paragraphe évocateur.
Je me garderai bien de chercher, en la matière, des lois universelles, me contentant de celle qui est clairement inhérente à la nature humaine, à savoir qu’il existe, chez tous ceux qui acquièrent une prééminence, un début d’aveuglement, et un risque d’ivresse. (Maalouf, 2023, p.389)
Des pages très révélatrices dévoilent la profonde déception de Maalouf, voire sa complète désillusion du mythe hégémonique ou de « l’impuissance de la puissance » (Badie, 2019, p.189), des pays aussi différents que la Chine, le Japon, la Russie, et même les Etats-Unis. Il écrit.
Les dieux rendent arrogant celui dont ils veulent la perte, disaient les Grecs anciens. Dans leur mythologie, où les sentiments étaient représentés par des divinités allégoriques, l’arrogance s’appelait Hubris. Tous les hommes qui parviennent à s’élever au-dessus de leurs semblables, par le statut, par la richesse, par la puissance, par le talent, ou même par la sainteté, croisent, un jour ou l’autre, le chemin de cette tentatrice. Et rares sont ceux qui savent lui résister. La chose est vraie des individus, ainsi que des communautés humaines, et singulièrement des nations. Les quatre dont je viens d’évoquer le parcours ne dérogent surement pas là la règle. Chacune d’elles avait le désir légitime de réparer les injustices, et chacune a fini par commettre, parfois à son corps défendant, des injustices plus flagrantes encore. (Maalouf, 2023, p.390)
Ne voyons-nous pas un besoin de se venger de la fragilité de ce mythe, de remiser la grammaire de la souveraineté, de réécrire le droit international, de globaliser les biens communs ?
Il nous faut reconnaitre que la notion badienne, développée dans cet essai, d’un monde hégémonique, de paix et de bonheur, échappant à nos craintes et à nos détestations, reste une pure fiction aux yeux de Maalouf. Il y a là une intention délibérée et très nette qui ne saurait être l’effet du hasard, et Maalouf note que l’hégémonie, qui a tant inspiré maintes stratégies militaires et politiques, et marqué profondément les relations internationales, n’a malheureusement jamais pu s’accomplir. Ce que Maalouf nous offre de plus précieux, c’est sa réflexion nouvelle d’un monde posthégémonique dans lequel les notions de pouvoir et de puissance sont actualisées et réinventées. Parce que le monde de demain contredit l’omnipotence, l’adhésion à un modèle unique et souligne le besoin de stabilité économique, de pluralité, « de sérénité, de vigilance, de solidarité » (Maalouf, 2023, p.418) dans la régulation des crises. En cette phase si fascinante et complexe de l’évolution de l’humanité, la posthégémonie se comprend « comme une traduction pratique de la mondialisation, considérant l’interdépendance, l’inclusion et la mobilité comme de nouvelles donnes incontournables, faisant en contrepoint écho là ce qu’étaient autrefois la souveraineté, la fragmentation civilisationnelle et la territorialité. » (Badie, 2019, p.209) N’est-ce pas là une nouvelle vertu ou une nouvelle illusion ?
Références bibliographiques
Corpus
Maalouf, A. (2023). Le Labyrinthe des égarés. Paris : Grasset et Fasquelle.
Autres œuvres de Maalouf
Romans
Maalouf, A. (1986). Leon l’Africain. Paris : Lattès.
(1988). Samarcande. Paris : Lattès.
(1991). Les Jardins de lumière. Paris : Lattès.
(1992). Le Premier Siècle après Béatrice. Paris : Grasset.
(1993). Le Rocher de Tanios. Paris : Grasset.
(1996). Les Echelles du Levant. Paris : Grasset.
(2000). Le Périple de Baldassare. Paris : Grasset.
(2004). Origines. Paris : Grasset.
(2012). Les Désorientés. Paris : Grasset.
(2020). Nos frères inattendus. Paris : Grasset.
Essais
Maalouf, A. (1983). Les Croisades vues par les Arabes. Paris : Lattès.
(1998). Les Identités meurtrières. Paris : Grasset.
(2009). Le Dérèglement du monde. Paris : Grasset.
(2016). Un fauteuil sur la Seine : Quatre siècle d’histoire de France. Paris : Grasset.
(2019). Le naufrage des civilisations. Paris : Grasset.
(2023). Le Labyrinthe des égarés. L’Occident et ses adversaires. Paris : Grasset.
Livrets musicaux
Maalouf, A. (2001). L’Amour de loin. Paris : Grasset.
(2002). Quatre instants. Paris : Grasset.
(2004). Adriana Mater. Paris : Grasset.
(2006). La Passion de Simone. Vienne.
(2010). Emilie. Lyon.
Discours
Malouf, A. (2014). Discours de réception de l’Académie Française. Paris : Grasset.
(2016). Un automne à Paris, chanson, avec Louane et Ibrahim Maalouf.
Préfaces
Maalouf, A. (1981). Pour une éducation bilingue : Guide de survie à l’usage des petits européens, Anna Lietti. Paris : Payot.
(1992). De la divination. Cicéron. Paris : Les Belles Lettres.
(1993). Le Prophète. Khalil Gibran. Paris : Le Livre de Poche.
(2007). La Batare d’Istanbul, Elif Shafak. (ISBN 978-2-264-04740-3)
Ouvrages de critique et de théorie littéraire
Allman, T.D. (1986). Un destin ambigu. Paris : Flammarion.
Badie, B. (2019). L’hégémonie contestée. Les nouvelles formes de domination internationale. Paris : Odile Jacob.
Bourdieu, P. (1979). La distinction. Paris : Minuit.
(1994). Raisons Pratiques. Points Essais : Seuil.
(2002). La domination masculine. Points Essais : Seuil.
Bush, G. (1991). Time Magazine. 28 janvier 1991.
Corm, G. (1991). Le Proche-Orient éclaté (1956-1991). Paris : Gallimard.
Crozier, M. (1980). Le Mal américain. Paris : Fayard.
Dabernat, R. (1965). Y a-t-il encore un supergrand ? Le Monde, 27 octobre 1965.
Domenach, J-M. (1972). Emmanuel Mounier. Paris : Seuil.
Fontaine, A. (1991). L’un sans l’autre. Paris : Fayard.
Julien C. (1968). L’Empire américain. Paris : Grasset.
Krauthammer, C. (1990-1991). The Unipolar Moment. Foreign Affairs, America and the world.
Lesseps, F. (1881). Lettres, journal et documents pour servir à l’histoire du canal de Suez. Paris : Didier
L’Huillier, F. (1954). De la Sainte-Alliance au pacte atlantique. La Baconnière : Neuchâtel. Tome I.
Paine, T. (1984). Les Droits de l’homme. Paris : Payot.
Roosevelt, E. (1947). Mon père m’a dit. Paris : Flammarion.
Saïd, E. (1980). L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris : Seuil.
Truman, H. (1945). Le Monde. 11 août 1945.
Valéry, P. (1945). Regards sur le monde actuel. Paris : Gallimard.
Voyenne, B. (1964). Histoire de l’idée européenne. Paris : Payot.
Williams, R. (1958). Culture and Society, 1780-1950. Londres : Chatto and Windus.
عدد الزوار:1318



